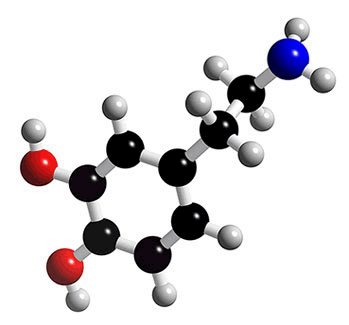L'écoute musicale :
En quoi l'écoute de la musique nous influence t-elle ?
1) Emotions :
a) Emotions provoquées
L'écoute d'une musique provoque en chacun de nous quelque chose d'affectif, nous allons allons nous interesser aux différentes dimensions influentes à cette écoute.
Tout d'abord la dimension émotionnelle, celle qui nous provoque des sentiments lors d'une écoute, par exemple si l'on aime pas.
La dimension sensorielle, celle qui provoque en nous des réactions physiques comme taper du pied, danser...
La dimension imaginative, provoquant des images issues de l'imagination de l'auditeur.
Ensuite la dimension nostalgique, nous rappelant certains souvenirs, certaines images, certaines situations.
La dimension analytique, c'est la quête de sens, lorsque l'exposition répétée développe des attentes vis-à-vis d'éléments structurels de la musique (tempo, mode, évolution de la mélodie, résolution harmonique).
Pour finir il y a dimension symbolique de la musique véhiculant un contenu sympbolique et abstrait, nous rapproche de certains "symboles", comme par exemple une musique contenant des violons stridents s'associe à un film d'horreur, la saxophone s'associe à une scène romantique etc ...
Quelqu'un désirant communiquer avecl'utilisation de la musique doit prendre compte de l'ensemble de ces dimensions.
Le tempo, le rythme, la fréquence, l'intensité et la structrure musicale sont d'autres facteurs permettant la communication.
Le tempo joue un rôle majeur, en étant rapide il peut exprimer la joie, la passion ou encore l'angoisse. Au contraire, quand il est lent il peut exprimer le calme, la tristesse. D'autre part, la régularité du tempo peut produire un effet sécurisant ou à l'inverse obsédant. Quant à l'irrégularité d'un tempo, elle engendre la plupart du temps de l'angoisse.
Le rythme est également très important. La répétition rythmique est fréquemment employée pour combattre l'angoisse. Renvoyant par exemple aux berçeuses et aux comptines. Elle peut apaiser des enfants, des handicapés mentaux. On utilise aussi la répetition rythmique dans les musiques d'induction au sommeil.
Les hautes fréquences (registre aigu), évoquent un monde idéal ou surnaturel, à l'inverse pour les basses fréquences (registre grave) font allusions au monde matériel ou infernal.
Des recherches sur l'intensité d'une oeuvre musicale ont menées à dire que pour un niveau d'intensité très faible, beaucoup d'oeuvres musicales ont un effet sécurisant alors qu'un d'intensité élevée est souvent générateur de stress. Quant à la structure musicale, si elle réussit à être perçue par l'auditeur, peut-être bénéfique. La répétition de rythme par exemple peut avoir un côté sécurisant et donner du plaisir à l'auditeur lors de l'écoute. Au contraire, elle peut déclencher des réactions d'angoisse ou d'aggressivité.
b) Les différents mécanismes biologiques et molécules :
Nous avons voulu connaître les effets de la musique lorsque ce qu'on écoute est une musique que l'on aime. Dans ce cas là, la musique a une action directe sur le cerveau : celle de faire secréter de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui a pour action de compenser des plaisirs comme la nourriture ou la drogue par exemple.
La formule brute de la dopamine est la suivante :

Ce sont les neurones impliqués dans le système de la récompense -également appelé système hédonique. Chez l’Homme, l’activation de ce système procure une sensation de plaisir. Le système hédonique se situe dans le système limbique, le cerveau des émotions. L’activation du système hédonique est déclenchée par un stimulus agréable -ici, écoute d'une musique agréable. Ceci a pour effet d’accroitre l’activité de certains neurones situés dans la région du tronc cérébral. Ces neurones, appelés neurones dopaminergiques, synthétisent la dopamine, une sensation de plaisir se fait alors ressentir.

Formule topologique
de la dopamine
Molécule de dopamine
QU’EST-CE QUE LA DOPAMINE ?
La dopamine est un neurotransmetteur issu de l’acide aminé tyrosine. C’est un précurseur de l’adrénaline. La dopamine est notamment impliquée dans le phénomène d’addiction mais aussi dans la motricité fine (les parkinsoniens manquent de dopamine) ou les fonctions intellectuelles et émotionnelles. La prise de drogues stimule la production de dopamine et celle-ci joue un rôle important dans les sensations de plaisir. Néanmoins, le niveau de dopamine dans le corps peut aussi s’emballer et provoquer des dépendances. Dans le cas de la consommation de substances dites « psychoactives » comme les drogues, le cerveau est régulièrement sollicité, ce qui entraîne une diminution de la production d'endorphines. La sensation de plaisir n’est alors obtenue que par l'apport de la substance extérieure, ce qui provoque une augmentation de la tolérance à cette substance et une sensation de manque dès l'arrêt de sa consommation. L'organisme devenant peu à peu insensible à la substance et à ses effets, le consommateur doit accroître les doses pour obtenir le même niveau de plaisir. C'est ce mécanisme dit de "renforcement positif" qui incite à répéter l'expérience agréable et entraîne la dépendance.
Pour être sur de cette influence sur notre corps nous avons réaliser un sondage et d'autres expériences, que vous pourrez découvrir par la suite.
2) La physiologie :
A) Différentes études
Les effets de la musique sur le corps humains sont nombreux. Plusieurs études concenant ces différents effets ont donc été réalisées afin d'obtenir des preuves de l'existence de ces effets. Cependant cette science reste cependant approximative et peu exploitée.
En effet plusieurs études ont pu être réalisé afin de prouver et démontré ces effets de la musique sur le corps humain. L'université de médecine de Montpellier réalisa plusieurs études. La première expérimentation portait des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, cette étude consistait à faire diminuer l'anxiété et la dépression chez ces derniers. Des patients ont donc suivi des séances de musicothérapie pendant 44 semaines, à la fin de ses 44 semaines on constate que l'anxiété et la dépression ont nettement baissées.
La seconde consistait à comparer deux systèmes de prise en charge de la douleur :a musicothérapie et la physiothérapie par radar chez 15 patients en rééducation. Suite à cette étude, ils ont démontré que les séances de musicothérapie avait un effet psycho-physiologique et qu'elle pouvait remplacer les médicaments comme les antalgique. Sur ces 15 patients, les résultats montrent une baisse de la douleur plus élevée grâce aux séances de musicothérapie de plus, d'après les patients, la musicothérapie entrainerait aussi une baisse de l'anxiété.
Une autre étude consistait à utiliser la musicothérapie active et réceptive pour observer l'évolution des paramètres psychomoteurs chez les personnes ayant subi un traumatisme crânien. Les patients ont suivi une séance hebdomadaire d'une heure de musicothérapie. Au fil du temps, on peut constater que les patients ayant suivi ces séances ont vu leur mémoire augmenté et une nette amélioration de leurs capacités psychomoteurs.
Une dernière étude portante sur les douleurs viscérales (cerveau, coeur, intestin, poumon, etc) chronique et aigues fut réalisée. Elle montra qu'une séance personnalisée d'écoute musicale pouvait mener à une modification de la sensation de douleur grâce à une contre-stimulation des fibres adhérentes, une modification de l'humeur, un détournement d'attention, une modification ou encore une décontraction des muscles. Il faut savoir que d'autres études montrent aussi un lien entre le rythme musical, la pression artérielle et la fréquence cardio-respiratoire.
On peut donc conclure que la musique permettrait de diminuer la douleur, et qu'elle pourrait même remplacer certains antalgiques. De plus elle peut permettre de stabilisé l'émotion de certaines personnes.
B) La physiologie des cellules
Il faut savoir qu'il n'y a pas que les sons qui peuvent être audibles (sons de fréquence moyenne) qui peuvent affecter notre organisme. En effet, les ultrasons nous affectent sur une échelle microscopique, plus particulièrement au niveau des cellules : des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de Pasadena ont constaté la formation de bulles émettant des éclairs bleuâtres à l'intérieur d'une boule en verre remplie d'eau lorsque des ultrasons étaient envoyés dessus. Ce phénomène appelé "sonoluminescence" modifie la matière, il s'agit donc d'une preuve qui permet d'affirmé que même les sons en dehors de la fréquence audible ont une action de type physique sur la matière et qu'il touche les cellules.
Notre corps lui aussi, produit des vibrations (rythme cardiaque, respiration, vibrations des cellules, etc), si ces vibrations produitent par notre corps ne sont pas en accord avec les vibrations provenant de l'extérieur, alors elles vont être modifiées pour s'adapter aux vibrations extérieur. Cela créera un déséquilibre et le corps réagira avec une hausse de la tension et du stress.
C) La musique dans le sport
Comme énoncé précédemment, la musique permet de diminué la douleur et de stabiliser l'émotion, ce système peut être utilisé dans le domaine du sport.
La musique facilite la coordination, elle permet en effet de se synchroniser sur un rythme pour effectuer des mouvements réguliers.
Plusieurs tests et études ont été effectuées afin de démontrer ces effets pour une utilisation sportive. Notamment au Japon, où des étudiants ont réalisés l'expérience suivante : 16 femmes de 50 ans devaient pratiquer le step avec un fond sonore différent (folklorique, musique aérobic et sans musique).Le test durait 60 minutes; après ce test les sujets devaient exprimer leurs ressenties.
Leur conclusion était que les sujets se sentaient moins fatigués avec une musique et que la musique arobic améliorait leur coordination et leur vigueur.
Une autre étude fut mené sur la course à pied. Sur une distance de 400 mètres, 7 athlètes ont couru un par un sans musique, puis la semaine suivante ils ont couru avec une musique rythmé (plus de 120 bpm). La majorité des athlètes avaient couru plus vite lors de la deuxième course. De plus ils disaient être moins fatigué que pour la première course.
On peut donc conclure que la musique permet bien d'améliorer les performances d'un sportif, mais la musique doit tout de même resté en accord avec la discipline exercée pour une meilleure efficacité.
La musique nous influence tellement qu'elle a été interdite dans les compétitions de course à pied.
3) La musique et nos capacités :
A) L'effet mozart
Nous avons vu précedemment que la musique classique avait le pouvoir d'améliorer les capacités d'apprentissage des souris. Nous avons donc fait d'autres recherches dans cette voie, notamment sur le célèbre "effet Mozart". Mais "l'effet Mozart", qu'est-ce que c'est?
Il s'agit d'une théorie emettant l'idée qu'écouter une composition musicale de Mozart aurait la faculté de rendre plus intelligent. Cependant, si l'on admet les effets de la musique sur le corps et sur les émotions, le monde de la science reste septique quant à son effet sur le raisonnement. C'est pourquoi des chercheurs du "Center for the Neurobiology of Learning and Memory" de l'Université de Californie à Irvine, ont réalisé les expériences suivantes, dans le but de confirmer ou non cette théorie.
Première étude sur l'effet neurophysiologique Mozart :
Frances H. Rausher, Gordon L. Shaw et leurs collègues ont voulu tester cet effet en soumettant 36 collégiens à trois conditions expérimentales d'une durée de 10 minutes chacune :
1. écouter la sonate pour deux pianos en ré majeur, K.448 de Mozart
2. écouter une cassette audio donnant des consignes de relaxation
3. demeurer en silence.
Dans les 15 minutes qui suivaient ces trois conditions expérimentales, les collégiens étaient soumis de raisonnement abstrait-visuel de Stanford-Binet : soit analyse de modèles, matrices ou pliage et découpage de papier.
Les scores moyens obtenus ont été convertis indices de quotient intellectuel (QI). Le groupe Mozart a obtenu un QI de 119 alors que les groupes de relaxation et silence ont eu un résultat de 111 et 110. L'analyse des statistiques nous montre que le groupe Mozart est plus performant dans les exercices de raisonnement abstrait-visuel. Le groupe Mozart diffère significativement des deux autres groupes, relaxation et silence, possédant des résultats quasiment similaires et inférieurs à ceux du groupe Mozart. L'effet Mozart mesuré dans cette recherche est l'effet produit par la sonate dans les 15 minutes. On ne sait ici si cet effet sur le raisonnement persiste au-delà des 15 minutes de la période de test.
Deuxième recherche sur l'effet Mozart :
C'est dans leur deuxième recherche de 1994 que ces mêmes chercheurs ont vérifié les bases neurophysiologiques de cette amélioration du raisonnement abstrait-visuel.
Pour cette étude, ce furent 79 étudiants qui ont été soumis à trois conditions expérimentales sur une période de 5 jours :
1. Ecouter la même sonate de Mozart, K.448, utilisée dans la première recherche.
2. Demeurer dans une situation silencieuse.
3.Ecouter une musique de Philip Glass, une histoire sur ruban audio et un morceau de danse.
Les sujets étaient ensuite évalués avec 16 figures abstraites semblables à des feuilles de papier pliées projetées sur un écran pendant une minute chacune. L'exercice consistait à dire à quoi ressembleraient ces figures si elles étaient dépliées. Les trois groupes ont améliorés leur résultats du jour 1 au jour 2 : la reconnaissance des figures dépliées par le groupe Mozart s'est élevée à 62% tandis que les groupes "silence" et "mixte" ont fait une performance respective de 14% et 11%. Durant les 3 jours suivants, le groupe Mozart a continué d'atteindre des plus hauts scores tandis que les performances des deuc autres groupes ne s'améliorèrent plus significativement.
Conclusion des deux expériences :
Selon les auteurs de ces deux recherches, l’écoute de la musique de Mozart contribue à calibrer la conduction nerveuse dans le cortex, particulièrement par le renforcement des processus créatifs de l’hémisphère droit associés au raisonnement spatio-temporel. Écouter Mozart faciliterait les opérations de symétrie associées aux plus hautes fonctions cérébrales, de même que la concentration et la pensée intuitive.
Selon ces chercheurs, la musique de Mozart "réchauffe" le cerveau parce qu’elle est une musique complexe et qu’elle a un effet sur les configurations neurologiques complexes impliquées dans les activités cérébrales, telles que les mathématiques et les parties d’échecs. Une musique simple et répétitive pourrait avoir l’effet inverse. D’après les effets neurophysiologiques notés dans les encéphalogrammes administrés lors d’études préliminaires et complémentaires, les auteurs voient une similitude entre la disposition des cellules nerveuses en colonnes dans le cortex cérébral et l’architecture de la musique de Mozart. La complexité de la musique de Mozart a été illustrée en spectrogrammes par Alfred Tomatis qui les a publiés dans son essai "Pourquoi Mozart ?" Mais pourquoi Mozart et pas d'autres compositeurs ? La réponse est que la musique de Mozart est accessible et compréhensible à tous, contrairement à celle de Bach ou de Beethoven qui nécessite plus de réflexion.
Ecouter Mozart permettrait donc d'améliorer nos capacités intellectuelles. Cependant, cette théorie rste quand même contrebalancé par d'autres expériences. Aujourd'hui, on admet que la musique de Mozart à des effets sur le QI que pour un court laps de temps et que en écouter régulièrement ne serait pas spécialement bénéfique.